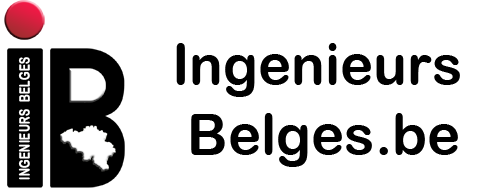Profil: Jean-Pierre Laurent

Jean-Pierre Laurent a derrière lui vingt ans d'une carrière dans une industrie où l'expertise belge est appréciée aux confins les plus exotiques de notre planète: l'industrie agro-alimentaire, entre autres du sucre et de l'huile alimentaire. Il nous raconte ce que cette expérience aux quatre coins du monde a à offrir, à lui mais aussi aux entreprises étrangères qui choisissent de travailler avec des Belges.
Quel a été votre parcours?
Au départ, j'ai fait un baccalauréat en chimie aux Facultés universitaires Notre-Dame-de-la-Paix à Namur, que j'ai complété par une maîtrise en ingénierie, en biochimie à l'ULB. Dans ce cadre, je suis parti en échange Erasmus à Paris dans une université financée par l'industrie du sucre. J'ai enchaîné avec un stage et un premier boulot à l'Île de la Réunion, dans la canne à sucre. Ça m'a plu, je me suis donc retrouvé au Congo-Brazzaville toujours pour la canne à sucre. La guerre civile là-bas m'a ramené en Belgique et j'ai commencé à travailler alors pour une société belge spécialisée dans l'huile alimentaire, comme ingénieur de chantier, puis comme ingénieur de projet et chef de Projet. Maintenant, je suis directeur technique au sein d'un ensemblier industriel spécialisé pour l'industrie sucrière, les biocarburants et l'huile alimentaire. Cette fonction comporte une partie de support à la vente, une partie opérationnelle et une partie de suivi des contrats, de coordination technique à travers divers projets. En 2013, j'ai passé 10-15% de mon temps en Argentine, 10-15% au Sierra-Leone, 10-15% en Inde (où certains équipements sont fabriqués). J'ai aussi été au Brésil et en Colombie. Ma carrière m'avait déjà amené en Chine, au Vietnam, au Chili au cours des dix-sept années précédentes... Et dans la société même, il y a un fameux brassage culturel.
|
Comment avez-vous combiné une carrière mouvementée avec votre vie privée? |
 Pourquoi ces industries étrangères font-elle appel à une société belge?
Pourquoi ces industries étrangères font-elle appel à une société belge?
La Belgique a une longue tradition d'expertise dans les domaines du sucre et de l'huile alimentaire: la Raffinerie Tirlemontoise a rayonné dans le monde entier. Cet atout technique nous permet de faire la différence à l'étranger. Outre cette connaissance de la betterave, nous avons connu le choc pétrolier: on s'est habitué à ne pas gaspiller, à gérer l'énergie efficacement, de manière durable. Et ça, c'est toujours bienvenu, au Brésil, entre autres. Ce pays, en produisant ses quantités astronomiques de sucre, utilise proportionnellement plus d'énergie qu'ailleurs. Cela importait peu tant que la source d'énergie - la bagasse, le résidu du traitement de la canne à sucre - était considérée comme un déchet à brûler. Or, aujourd'hui, en brûlant cette bagasse dans des cogénérations modernes, on peut exporter plus de courant: c'est bienvenu dans un pays en pleine croissance et où la demande électrique ne cesse de croître, comme le Brésil.. C'est par exemple là que des groupes sucriers installés, font appel à nous pour un audit de leur consommation d'énergie!
De plus, souvent, on reconnaît une certaine humilité aux Belges: ce sont des commentaires que j'ai entendus au Chili, en Argentine. Un mélange de flexibilité et de rigueur dans le travail aussi: «vous avez la rigueur des Allemands mais le sens de la communication des peuples latins» m'a dit un client sud-américain, devenu un ami. Évidemment, dans une carrière internationale, la maîtrise des langues étrangères est un facteur de réussite: les Belges sont prêts à devenir polyglottes, et c'est un de leurs avantages! Communiquer dans la langue de nos clients, montrer qu'on fait cet effort, ce pas vers eux, c'est une marque de respect essentielle. Parfois, c'est tout simplement difficile de passer outre l'apprentissage d'une nouvelle langue. Quand j'étais en Slovénie, j'ai appris l'allemand en cours du soir dans la ville voisine, Maribor: j'avais le choix entre l'allemand ou le slovène pour communiquer avec les ingénieurs locaux!
Et vous, qu'avez-vous retiré de ces plongées dans des univers culturels si contrastés?
Beaucoup, beaucoup d'énergie et d'appétit pour le travail: on voit ces gens qui travaillent, qui veulent apprendre, croître, se développer. C'est contagieux! On réalise aussi que de bons ingénieurs, il y en a partout: au Ghana, en Argentine, au Brésil... Tous ces gens venus de pays émergents ont soif de (re)connaissance. Si on veut qu'ils aient une raison de continuer à faire appel à nous, à notre expertise, nous n'avons pas le droit de nous reposer sur nos lauriers: de notre côté aussi, il faut rester sur le qui-vive et s'améliorer sans cesse. Un bon diplôme dure cinq ans, certainement pas vingt! Au cours de ma carrière, j'ai saisi différentes occasions de continuer à me former, à Toulouse à The Ethanol Technology Institute (2010) ou au Zuckerinstitut de Berlin (2004) comme à des sessions organisées par des entreprises spécialisées.
 Quand vous vous retournez sur ces 20 dernières années, quelle est votre impression?
Quand vous vous retournez sur ces 20 dernières années, quelle est votre impression?
J'ai beau avoir passé 17 de ces années dans la même société, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un boulot différent chaque année! Ma carrière n'a vraiment pas été monolithique, loin de là... D'abord, nos clients nous engagent pour une étude de faisabilité - de trois ou quatre mois - comme pour des projets «clé en main», à mener de A à Z donc sur une période d'environ deux ans. Et puis, en passant d'une sphère culturelle à l'autre, on est sans cesse bousculé dans ses certitudes et remis en question. Vraiment, c'est le boulot rêvé: une foule de disciplines s'y croise - de la physique, de la chimie, de la thermique, mais aussi des relations humaines et des approches culturelles, économiques, des plus variées. Les défis sont toujours au rendez-vous, on est loin de l'image cliché du travail d'ingénieur statique, figé au même bureau pendant des décennies!
Les jeunes ingénieurs, qu'en dites-vous?
Ces dernières années, la société qui compte plus ou moins 150 employés a engagé entre trois et cinq ingénieurs chaque année. Et ça a été un sans-faute: tous sont brillants, motivés et bien formés. Nous avons des équipes mixtes, même si nous ne nous préoccupons pas de parité en tant que telle: nous donnons une chance aux gens en fonction de leurs compétences.
Je remarque aussi que les auditoires de biochimie se remplissent: de mon temps, nous étions dix sur les bancs de l'université, aujourd'hui beaucoup plus. En fait, l'industrie chimique, de plus en plus, s'inspire de la vie: dans ses transformations, elle cherche à copier la nature et à réaliser au passage des économies d'énergie.
Le mot de la fin? |