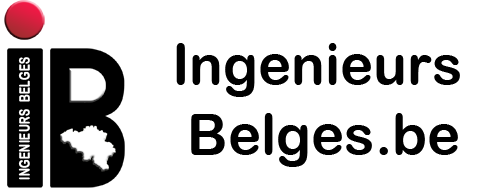François Van Wetter : Le Sud au coeur

François Van Wetter est un agronome qui a vu le monde: son goût pour l’aventure et la nature l’a emmené de l’Afrique à l’Amérique latine, des endroits les plus reculés aux capitales en plein développement de ces pays. Coup d’oeil sur son parcours, sur les raisons qui amènent des Européens à se faire embaucher à ces postes internationaux et sur l’expérience personnelle qu’on en retire.
Quel a été votre parcours à l’étranger?
Tout a commencé à la fin de mes études, par un stage de deux-trois mois au Kenya, dans une région superbe, la vallée du Rift. Ensuite, diplôme d’agronomie en poche et service militaire derrière moi, je suis retourné en Afrique, mais cette fois au Congo, qu’on appelait alors le Zaïre. Vers la fin des années 80, j’y ai travaillé dans des plantations de tabac en milieu rural - on produisait du tabac, qui était ensuite séché à la fumée et avait donc un goût et une odeur caractéristique. Cette culture demande beaucoup de main-d’oeuvre, sans pour autant être plus rentable que d’autres cultures. Elle se fait toujours dans des lieux reculés, où elle ne subit pas la concurrence d’autres cultures moins exigentes. Bref, tabac oblige, j’ai passé deux ans au fin fond de la brousse.  Ma zone d’action était grande comme la Belgique et j’y étais le seul Européen à l’exception des missionnaires chez qui je résidais lorsque j’étais en déplacement. C’était une de ces vieilles générations de missionnaires, les nonnes allaient à la pêche, conduisaient leur jeep, buvaient leur petite bière le soir... Nous complétions sur le terrain la formation des techniciens locaux. Au point de vue professionnel, évidemment, j’avais pas mal de responsabilités et mon sens de la débrouille était mis à profit. En général, en tant que Belge, j’étais bien vu, un peu à la façon d’un «cousin de papa revenu au pays». D’une certaine façon, je bénéficiais d’une rente de situation parce que j’étais là où peu de jeunes étaient disposé à travailler. Après ces deux ans dans le tabac, j’ai travaillé dans des plantations d’huile de palme et de caoutchouc. On usinait également du riz. L’entreprise employait 600 travailleurs et j’avais là avec moi un collègue portugais. parfois les trains ne roulaient pas et la paie des ouvriers n’arrivait donc pas, car nous ne pouvions sortir nos récoltes... D’un point de vue humain, l’isolement était grand et les échanges intellectuels en pleine brousse se faisaient bien rares! Ça, c’était assez dur. C’était l’aventure, le choc culturel: il fallait composer avec des histoires de sorcellerie par exemple... Je me suis même retrouvé quelques jours en prison, dont les murs étaient tellement fragiles que le directeur venait nous remercier au petit matin de ne pas avoir pris la poudre d’escampette. À la fin des années 80, de l’ère Mobutu, l’inflation était énorme, jusqu’à 100% par jour. Cela nous obligeait à recourir au troc: j’ai dû payer mes ouvriers en savons!
Ma zone d’action était grande comme la Belgique et j’y étais le seul Européen à l’exception des missionnaires chez qui je résidais lorsque j’étais en déplacement. C’était une de ces vieilles générations de missionnaires, les nonnes allaient à la pêche, conduisaient leur jeep, buvaient leur petite bière le soir... Nous complétions sur le terrain la formation des techniciens locaux. Au point de vue professionnel, évidemment, j’avais pas mal de responsabilités et mon sens de la débrouille était mis à profit. En général, en tant que Belge, j’étais bien vu, un peu à la façon d’un «cousin de papa revenu au pays». D’une certaine façon, je bénéficiais d’une rente de situation parce que j’étais là où peu de jeunes étaient disposé à travailler. Après ces deux ans dans le tabac, j’ai travaillé dans des plantations d’huile de palme et de caoutchouc. On usinait également du riz. L’entreprise employait 600 travailleurs et j’avais là avec moi un collègue portugais. parfois les trains ne roulaient pas et la paie des ouvriers n’arrivait donc pas, car nous ne pouvions sortir nos récoltes... D’un point de vue humain, l’isolement était grand et les échanges intellectuels en pleine brousse se faisaient bien rares! Ça, c’était assez dur. C’était l’aventure, le choc culturel: il fallait composer avec des histoires de sorcellerie par exemple... Je me suis même retrouvé quelques jours en prison, dont les murs étaient tellement fragiles que le directeur venait nous remercier au petit matin de ne pas avoir pris la poudre d’escampette. À la fin des années 80, de l’ère Mobutu, l’inflation était énorme, jusqu’à 100% par jour. Cela nous obligeait à recourir au troc: j’ai dû payer mes ouvriers en savons!
 J’ai ensuite travaillé dans un bureau d’études en Belgique pendant une période assez brève puis suis reparti vers la Guinée Conakry pour les brasseries Unibra. Nous produisions et commercialisions des fruits d’exportation (mangues, ananas) afin d’obtenir des devises permettant ainsi d’importer les matières premières et fournitures destinées à la production de la brasserie (bouteilles, capsules, houblon et autres). Après cette expérience, j’ai traversé l’Atlantique pour me retrouver quelques années en Équateur, puis en Amérique centrale - de Panama, je rayonnais dans cinq pays de la région – puis enfin, au Pérou, à Lima. Entre l’Amérique du Sud et l’Afrique, il y a un monde de différence: l’écart culturel m’a semblé moindre en Amérique du Sud, et le niveau de confort était nettement plus élevé qu’en Afrique à l’époque.
J’ai ensuite travaillé dans un bureau d’études en Belgique pendant une période assez brève puis suis reparti vers la Guinée Conakry pour les brasseries Unibra. Nous produisions et commercialisions des fruits d’exportation (mangues, ananas) afin d’obtenir des devises permettant ainsi d’importer les matières premières et fournitures destinées à la production de la brasserie (bouteilles, capsules, houblon et autres). Après cette expérience, j’ai traversé l’Atlantique pour me retrouver quelques années en Équateur, puis en Amérique centrale - de Panama, je rayonnais dans cinq pays de la région – puis enfin, au Pérou, à Lima. Entre l’Amérique du Sud et l’Afrique, il y a un monde de différence: l’écart culturel m’a semblé moindre en Amérique du Sud, et le niveau de confort était nettement plus élevé qu’en Afrique à l’époque. 
Entre le Panama et le Pérou, je me suis posé quelques années en Belgique, où je me suis consacré à quelque chose de tout à fait différent: la fonderie d’art. Je me suis aussi marié... avec une Colombienne! En Amérique du Sud, c’est à des projets de coopération pour la Commission européenne que je me suis dédié. Depuis 2010, de retour en Belgique, je collabore à un programme de sécurité sanitaire des aliments venus d’Afrique, des Caraïbes, du Pacifique (les pays ACP). C’est positif, notamment du point de vue de la vie de famille et de la scolarité des enfants qui sont ravis d’être ici en Belgique.
Pourquoi a-t-on recruté un Européen, comme vous, dans des pays en voie de développement?

À l’époque, les Européens bénéficiaient d’une sorte d’aura: les avoir dans une fonction à l’étranger donnait confiance aux commanditaires européens, on se disait qu’un gestionnaire européen allait faire preuve d’honnêteté et de rigueur. Aujourd’hui, la donne a changé: les plantations d’huile de palme, par exemple, sont souvent gérées par des asiatiques, des Malaisiens ou des Indonésiens. Et le niveau des ingénieurs n’a cessé de
s’ améliorer à travers le monde et avec l’e-learning, maintenant, beaucoup ont l’occasion de se former.
Quels aspects de votre formation se sont révélés bien utiles?
Au départ donc, j’ai un diplôme d’ingénieur agronome. Ma formation de départ était sans doute plus généraliste que le diplôme que la génération actuelle décroche. Je n’y avais pas acquis la moindre notion de gestion et donc, à la sortie, pendant que j’effectuais mon service militaire, j’ai suivi également une licence en gestion les soirs à l’ULB, à Solvay. Et ça, ça m’a été bien utile: j’ai finalement plus souvent travaillé comme administrateur de projets dans des domaines liés à la nature que comme agronome pur et dur. D’ailleurs, j’ai plutôt fait de l’agriculture que de l’agronomie au cours de ma carrière.

Qu’avez-vous retiré de votre parcours?
Une expatriation comme coopérant, c’est tout à fait autre chose qu’une expatriation envoyé par une grande entreprise internationale. En coopération, on est beaucoup en interaction avec les gens du cru. Ce qui compte, c’est d’être mobile - pas seulement géographiquement, physiquement, mais également dans sa tête. Face à tout ce qui est étranger, il faut accepter de s’ouvrir, de s’adapter et de se remettre en question.
En général, je dirais que dans l’Afrique profonde que j’ai connue, si l’échange académique de haut vol était rare, j’avais une vie sociale enrichissante, mais elle était différente, nourrie par d’autres informations que celle qu’on reçoit en Belgique. On est intrigué alors, et on essaie de comprendre comment les gens de là-bas raisonnent. On apprend beaucoup, c’est vraiment fascinant. Je suis émerveillé par le miracle permanent d’Africains qui parviennent à joindre les deux bouts au jour le jour. Et j’ai beaucoup d’admiration pour tous ces jeunes, au Pérou ou dans le reste du monde, qui travaillent pour se payer des études là-bas très onéreuses. Beaucoup de jeunes de ces pays aspirent à améliorer leur situation. Ils en veulent, ils sont pleins d’énergie! L’Europe ne peut plus se permettre de croire qu’elle ait naturellement droit à quoi que ce soit...